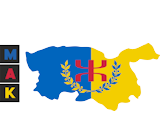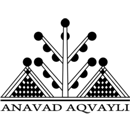-
Conférence du MAK à l’université Mouloud Mammeri : Le peuple kabyle doit disposer de lui-même
” Le droit international repose sur l’autodétermination, initialement appelée droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, un droit selon lequel chaque peuple dispose d’un choix libre et souverain de déterminer son statut politique, indépendamment de toute influence étrangère. » 15/04/2013 – 21:20 mis a jour le 15/04/2013 – 21:20 par Mohand T.
Avant d’animer, dans l’après-midi du 14 avril, une conférence-débat à l’auditorium de l’université Mouloud Mammeri, les responsables du Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie (MAK), Bouaziz Ait Chebib et Hocine Azem ont improvisé une prise de parole, dans la matinée, à 10h30 à Souk Elhed, dans la commune de Timizart pour appeler le peuple kabyle à la fraternité devant la disparition programmée par le régime. ” Le 20 avril est une occasion historique pour affirmer notre union et notre détermination à aller jusqu’au bout de notre combat. Le MAK, le RCD , le FFS sont de la même famille malgré nos divergences. Notre seul ennemi c’est le régime raciste d’Alger. Unissons-nous pour soustraire la Kabylie à ses griffes arabo-islamique”.
Dans l’après midi, le président du MAK, Bouaziz Ait Chebib, Hocine Azem , secrétaire national aux relations extérieures, ont animé une conférence-débat à l’auditorium de l’université Mouloud Mammeri, sur invitation du comité de l’institut des sciences économiques, sur le thème : le droit international et les peuples autochtones.
Le président du MAK, le premier à intervenir a développé le droit des peuples à se disposer d’eux-mêmes. ” Le droit international repose sur l’autodétermination, initialement appelée droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, un droit selon lequel chaque peuple dispose d’un choix libre et souverain de déterminer son statut politique, indépendamment de toute influence étrangère. » Le président du MAK insiste sur le fait que ce droit constitue la colonne vertébrale de tous les textes onusiens et parmi eux, l’article 1er commun aux deux pactes (pacte international relatif aux droits politiques et civils, pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) selon lequel, les peuples ont non seulement le droit d’assurer : « librement leur développement économique, social et culturel », mais aussi de « disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. » En se référent aux principaux textes onusiens (Charte, Pactes, Déclarations et résolutions de l’Assemblée générale), il ressort que la jouissance du droit des peuples à l’autodétermination dépend en particulier des éléments suivants : • le libre choix du statut politique et du développement économique, social et culturel ; • la souveraineté des peuples sur leurs ressources naturelles ; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels précise encore dans son article 25 qu’ : « aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles. » • l’égalité de droits des peuples ; • la non-discrimination ; • l’égalité souveraine des Etats ; • le règlement pacifique des différends ; • la bonne foi dans l’accomplissement des obligations et dans les relations internationales ; • le non-recours à la force ; • la coopération internationale et le respect de la part des Etats de leurs engagements internationaux, en particulier en matière de droits humains.
Le président du MAK a rappelé que « l’Algérie a ratifié tout les pactes, et a même consacré dans la constitution le principe de soutenir tous les peuples qui luttent pour leur autodétermination. Mais l’objectif du pouvoir est tout simplement de soutenir les palestiniens et les sahraoui, le reste des peuples opprimés ne sont même considérés comme tels étant donné que l’Algérie officielle nie l’existence des peuples d’Algérie qui ne se reconnaissent pas dans l’arabité ».
Le président du MAK a déploré le fait que la décolonisation ait débouché sur le néocolonialisme étant donné que la plupart de ces Etats « qui ont acquis leurs indépendance » restent encore économiquement et politiquement dépendants des anciennes puissances coloniales. Il a insisté sur le fait qu’à l’intérieur de nombreux Etats, de nombreux peuples continuent à être opprimés, ou tenus en position subalterne. Le cas des amazighs est plus qu’édifiant en la matière. Pour le conférencier : “Les peuples Amazigh doivent se disposer d’eux-mêmes pour ne pas disparaître”.
Le président du MAK s’est montré déçu par le fait que certains kabyles tentent encore de réduire le combat aux seules revendications culturelles et linguistiques alors que le droit international leur garantit un droit imprescriptible et inaliénable de se disposer d’eux-mêmes. ” Rien ne vaut un Etat pour un peuple ou une langue”.
Il conclue le premier chapitre du thème de la conférence en déclarant : “En ratifiant la charte des nations unies, l’Algérie a le devoir de respecter le droit à l’autodétermination d’abord en Algérie et de favoriser la réalisation du droit des peuples à l’autodétermination et d’aider l’ONU à s’acquitter de ses responsabilités dans l’application de ce principe. Alors usons de ce droit pour aller vers l’instauration d’un Etat Kabyle ». Dans le débat, le président du MAK a mis l’accent sur la nécessité de lutter sur les tous les fronts : national et international pour arracher le droit du peuple kabyle de choisir librement son destin. A cet effet, il a rappelé à l’assistance que : « le Gouvernement Provisoire Kabyle (GPK) qui est un gouvernement de combat n’aspire pas à gouverner la Kabylie. Sa seule mission consiste à obtenir la reconnaissance internationale de l’Etat Kabyle qui est en marche. Et le MAK s’auto-dissoudra une fois que l’objectif est atteint ».
Hocine Azem a, de son côté, développé le volet relatif aux peuples dans un exposé détaillé en traitant la question sur tous les plans. Voici un extrait de sa communication : « Dans de nombreuses régions du monde, les peuples autochtones sont depuis longtemps victimes d’une discrimination et d’une exclusion qui les ont placés en marge des sociétés dans lesquelles ils vivent. Ils ont pour cette raison de grandes difficultés à maintenir et à améliorer leur propre modèle de développement et leur qualité de vie et sont par conséquent touchés de façon disproportionnée par la pauvreté et l’exclusion. En vertu des principes fondamentaux d’universalité, d’égalité et de non-discrimination, les peuples autochtones devraient pouvoir bénéficier de tous les droits consacrés par les traités internationaux. Cependant, en tant que collectivités, les peuples autochtones ont des cultures et des visions du monde qui leur sont propres et leurs besoins actuels et leurs attentes peuvent être différents de ceux du reste de la population. Ce n’est qu’en reconnaissant et en protégeant non seulement leurs droits individuels, mais également leurs droits collectifs en tant que groupes distincts, que l’on pourra garantir le respect, dans des conditions d’égalité, de leur valeur et de leur dignité. C’est lorsque ces droits sont affirmés à titre collectif qu’ils pourront véritablement se réaliser. Ce constat a donné lieu à un ensemble d’instruments internationaux visant à reconnaître et à protéger les droits des peuples autochtones. Les programmes d’intervention des équipes de pays des Nations Unies devraient reconnaître la spécificité des situations et des cultures des peuples autochtones selon une approche de l’élaboration de programmes qui soit fondée sur les droits et tienne compte des besoins particuliers des femmes, des enfants et des jeunes autochtones. Il convient en particulier de prendre en compte les propositions des peuples autochtones visant à intégrer leurs droits sociaux, politiques, culturels et économiques et leurs aspirations dans les futures stratégies de développement, afin de véritablement tenir compte de leurs difficultés, de garantir le respect de leurs droits et de leurs cultures et de préserver leur survie et leur qualité de vie. Dans ce contexte, la participation des peuples autochtones, y compris des femmes autochtones, est un principe fondamental. Les équipes de pays des Nations Unies sont tenues d’intégrer, d’accepter et de respecter ces visions du monde et ces conceptions de la qualité de vie, y compris l’importance du milieu naturel et la nécessité de vivre en harmonie avec celui-ci. En outre, ces programmes d’intervention doivent tenir compte du fait que certains autochtones, par exemple les femmes et les enfants ou les personnes handicapées, sont souvent victimes de multiples formes de discrimination, de leurs propres peuples ainsi que plus généralement dans la société dans laquelle ils vivent. Les équipes de pays devraient également avoir conscience de la diversité qui existe entre différents peuples autochtones et de leurs intérêts parfois contraires d’un peuple à l’autre. L’adoption de nouvelles normes internationales au cours des deux dernières décennies permet aux équipes de pays des Nations Unies de renforcer leurs partenariats avec les États, les peuples autochtones et la société civile dans son ensemble. Ces nouvelles normes constituent un cadre de référence permettant de renforcer l’action menée en faveur des peuples autochtones à l’échelle nationale. Il s’agit notamment de l’adoption en 1989 de la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, du Sommet mondial des chefs d’État de 2005, au cours duquel les gouvernements se sont engagés à progresser en faveur de la réalisation des droits fondamentaux des peuples autochtones, de la proclamation par l’Assemblée générale de la deuxième Décennie internationale des peuples autochtones (2005 – 2014) et, plus récemment, de l’adoption par l’Assemblée générale en septembre 2007 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Au sein du système des Nations Unies, deux mécanismes importants ont été établis pour s’occuper des questions des peuples autochtones. L’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, composée de seize experts indépendants, dont un grand nombre d’autochtones, est chargée d’examiner les questions autochtones relatives au développement économique et social, à la culture, à l’environnement, à l’éducation, à la santé et aux droits de l’homme et de formuler des recommandations au système des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et social. Le mandat de l’Instance permanente consiste également à mener une action de sensibilisation et à favoriser l’intégration et la coordination des activités relatives aux questions autochtones au sein du système des Nations Unies et à produire les supports d’informations nécessaires. Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones a été nommé par la Commission des droits de l’homme (qui est depuis devenue le Conseil des droits de l’homme) et a pour mission d’effectuer des visites de pays, de rendre compte de l’évolution de la situation et de porter des cas de violation des droits de l’homme à l’attention des gouvernements. Le système des Nations Unies a répondu à ces appels à l’action en renforçant et en officialisant les activités de coopération qu’il mène depuis longtemps sur les questions autochtones, avec la création du Groupe d’appui inter-organisations sur les questions autochtones. En juillet 2006, dans le cadre de la promotion de la deuxième Décennie internationale des peuples autochtones, le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) a recommandé que le Groupe d’appui fournisse un appui et des conseils aux fins de l’intégration des questions autochtones dans les activités opérationnelles des Nations Unies, en remplissant les fonctions d’équipe spéciale auprès du GNUD. L’équipe spéciale sur les questions autochtones a ainsi été établie afin d’élaborer des directives portant sur l’intégration des questions autochtones dans les mécanismes et processus du système des Nations Unies à l’échelle des pays et de définir un plan d’action visant à les mettre en œuvre”.
Le Conférencier souligne d’emblée : « la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources » en ajoutant « toutes les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d’individus en se fondant sur des différences d’ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes . » En répondant aux questions des étudiants le conférencier insiste sur « le contrôle par les peuples autochtones des événements qui les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins ».
En se référant notamment à l’article 08 de la Déclarations des Nations-Unies sur les Droits des Peuples Autochtones qui met en exergue : 1 – Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.
2 – Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre.
3 – Les autochtones ont le droit, en tant que peuple et en tant qu’individus, de ne pas être soumis à l’assimilation forcée ou à la destruction de leur culture.
4- Les États mettent en place des mécanismes de réparation efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les priver de leur intégrité en tant que peuples distincts ou de leurs valeurs culturelles ou identité ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée à d’autres cultures ou modes de vie imposée par des mesures législatives, administratives ou autres ; et e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter. » Mohand T.